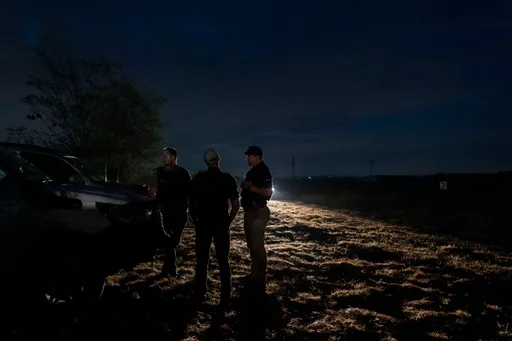Par Ahmet Arda Sensoy
La Syrie émerge de plus d'une décennie de guerre civile ; son avenir reste profondément incertain. Les rivalités régionales et les interventions étrangères continuent de façonner la reprise du pays.
Trois dynamiques se démarquent : les attaques répétées d'Israël et ses politiques de fragmentation, la réponse timide de la communauté internationale, et le rôle émergent de la Turquie comme potentiel garant de la stabilité. Ces éléments forment les pièces d'un puzzle complexe.
Cela soulève des questions clés. Quel est le véritable objectif d'Israël en Syrie ? Pourquoi le monde est-il resté largement silencieux face à l'intensification de ses frappes après la guerre de Gaza ? L'inclusion éventuelle de la Syrie dans les Accords d'Abraham pourrait-elle répondre aux préoccupations sécuritaires d'Israël ? Et où la Turquie devrait-elle se positionner dans cet environnement en mutation ?
L'objectif d'Israël en Syrie
La première dynamique est la campagne d'Israël visant à maintenir la Syrie fragmentée. En plus du génocide en cours à Gaza, Tel-Aviv mène également des attaques et des tentatives d'occupation contre des pays voisins.
Depuis le 7 octobre, en raison de la paranoïa sécuritaire dans laquelle il est entré, Israël s'est engagé dans un cycle de guerres incontrôlées et interminables pour rétablir sa dissuasion ébranlée. En même temps, cela reste le seul moyen pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu de maintenir son gouvernement d'extrême droite en place.
Dans le contexte syrien, Israël agit dans la continuité de ses politiques passées. Ce qu'il tente de faire en Syrie repose sur le principe connu sous le nom d'« alliance de la périphérie », qui consiste à coopérer avec des minorités et des pays périphériques pour affaiblir les États arabes hostiles dans la région.
Le soutien politique et militaire accordé aux groupes druzes dirigés par Hikmat al-Hijri trouve ainsi sa logique dans ce cadre.
Les Druzes sont une petite mais significative minorité arabophone en Syrie, comptant environ un million de personnes, principalement concentrées à Suwaida, près des frontières israélienne et jordanienne.
En juillet, des affrontements ont éclaté entre des Arabes bédouins et des groupes druzes dans la région. Lorsque Damas a déployé des troupes pour rétablir l'ordre, Israël a lancé des frappes aériennes contre les forces gouvernementales, affirmant protéger les minorités contre des massacres. L'incident a révélé comment Tel Aviv exploite les lignes de fracture locales, en particulier parmi les Druzes, pour entraver la recentralisation de la Syrie.
Cela s'inscrit dans un calcul israélien plus large. Du point de vue d'Israël, une Syrie stabilisée après Assad, reposant sur une légitimité populaire, une reprise économique et une souveraineté territoriale restaurée, serait le pire des scénarios.
Un Damas fort pourrait refuser à Israël la liberté de mener des raids transfrontaliers, de transférer des armes à ses alliés à volonté et de manipuler des acteurs non étatiques.
Ainsi, Israël a plutôt cherché à s'assurer que la Syrie reste un État fragile, dominé par des rivalités internes, des milices irrégulières et des interventions étrangères.
Cela s'est manifesté par le soutien israélien aux factions druzes ou par l'approbation des efforts séparatistes du groupe terroriste PKK/YPG, comme moyen d'éroder l'autorité centrale syrienne.
Paradoxalement, Netanyahu a souvent déclaré qu'Israël ne permettrait pas à la Syrie de « devenir un autre Liban ». Pourtant, en pratique, la politique israélienne pousse la Syrie précisément vers ce modèle libanais de fragmentation sectaire en refusant à l'armée syrienne de réintégrer les territoires du sud, en lançant des frappes aériennes répétées et en favorisant des conditions de pluralisme militaire.
Ce qui inquiète particulièrement Israël, c'est la perspective du rôle croissant d'Ankara en Syrie. Pendant la guerre civile, la Turquie a supporté les coûts élevés d'accueil de millions de réfugiés et s'est imposée comme le principal soutien de l'opposition syrienne contre le régime d'Assad renversé.
Aujourd'hui, dans l'environnement post-guerre civile, Ankara se repositionne. Un rapprochement potentiel entre la Turquie et la Syrie, surtout s'il est accompagné d'une réduction du soutien américain au PKK/YPG, pourrait simultanément renforcer la souveraineté de Damas, étendre l'influence régionale de la Turquie et limiter la capacité d'Israël à agir unilatéralement sur le territoire syrien.
Ainsi, le discours sécuritaire d'Israël dissimule ce qui est en essence une stratégie visant à maintenir le luxe d'une intervention non contrôlée dans les États arabes voisins, un luxe menacé par l'influence croissante de la Turquie.
La tâche impossible : les Accords d'Abraham
En traitant la force militaire comme son outil par défaut, Tel Aviv risque d'enfermer la Syrie dans un état perpétuel de fragmentation et d'aggraver le danger d'un conflit régional plus large. Parallèlement, la communauté internationale a largement normalisé les violations de la souveraineté syrienne par Israël.
Malgré la présence de casques bleus de l'ONU le long de la frontière syro-israélienne du Golan en vertu de l'accord de désengagement de 1974, Israël a saisi l'opportunité en novembre 2024 pour occuper la zone tampon.
Au cours des neuf mois qui ont suivi, il a mené une invasion terrestre et lancé plus de 500 frappes aériennes sur le territoire syrien. Bien que l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie ait condamné ces actions, les agences de l'ONU n'ont pris aucune mesure concrète en réponse.
En conséquence, les attaques d'Israël, cohérentes avec son comportement tout au long de la guerre civile, restent sans réponse de la part de la communauté internationale. Plutôt que de défier l'agressivité de Tel-Aviv, la communauté internationale, en particulier les États-Unis, s'est concentrée sur le fait de rassurer Netanyahu qu'une Syrie stabilisée ne menacerait pas la sécurité israélienne.
La logique est simple : si Damas pouvait être réhabilité en incluant la Syrie dans les Accords d'Abraham d'une manière alignée sur les intérêts du Golfe et des États-Unis, il cesserait d'être un acteur de première ligne contre Israël, et la normalisation s'approfondirait.
Israël, cependant, diverge fortement de cette vision. Plutôt que de voir la réintégration de la Syrie comme une garantie de sécurité à long terme, le gouvernement de Netanyahu préfère le luxe des frappes et interventions unilatérales.
Dans le calcul de Tel-Aviv, une Syrie faible et fragmentée préserve plus efficacement la domination régionale d'Israël qu'un État reconstruit lié à la Turquie et au Golfe.
La préférence d'Israël pour une Syrie divisée et faible peut être attribuée à sa liberté continue d'intervenir en Syrie, ainsi qu'à sa crainte qu'une Syrie stable puisse conduire à l'émergence d'un régime anti-israélien dans la région.
Contrairement au régime d'Assad, un gouvernement soutenu par la majorité de la population pourrait, après avoir atteint une stabilité économique et politique, agir contre l'occupation et les attaques d'Israël sur le Golan occupé. De plus, ces derniers jours, Netanyahu a déclaré : « Je ne suis pas naïf, je sais à qui j'ai affaire » en parlant du gouvernement syrien.
En résumé, pour Washington, la priorité est une Syrie « apprivoisée » intégrée dans un ordre de sécurité régional ; pour Tel Aviv, la priorité est de maintenir la capacité de frapper le territoire syrien à volonté. Les Accords d'Abraham illustrent donc la tâche impossible de concilier ces approches divergentes.
La Turquie comme stabilisateur et équilibrant
Les neuf derniers mois ont montré que, tandis qu'Israël déstabilise, Ankara pourrait stabiliser en Syrie.
Le partenariat potentiel de la Turquie avec Damas pourrait représenter une véritable voie vers la stabilité, y compris une coopération militaire pour renforcer la formation, l'équipement et les capacités conventionnelles de l'armée syrienne.
Pour la communauté internationale, la leçon est claire : engager et soutenir la Turquie dans un rôle constructif, plutôt que d'ignorer l'agression israélienne, pourrait être la voie la plus efficace vers une véritable désescalade en Syrie.
La Turquie, avec son influence sur le dossier syrien et sa diplomatie régionale pragmatique, a montré sa capacité à agir comme un contrepoids et à empêcher l'escalade de basculer dans un conflit incontrôlable.
Le partenariat Turquie-Qatar offre un modèle précieux. De la même manière, un rapprochement Turquie-Syrie pourrait évoluer en un mécanisme conjoint pour contenir l'agression israélienne.
Chaque frappe israélienne, paradoxalement, rapproche Damas d'Ankara, tout en aiguisant les perceptions turques de la menace israélienne. La possibilité d'une coopération militaire, économique et politique turco-syrienne, surtout si Washington réduit son soutien au PKK/YPG, constitue précisément le type d'alignement régional que Tel Aviv redoute.
Pendant la guerre civile, la Turquie a réussi à traiter avec la Russie, l'Iran et des acteurs non étatiques ; dans la nouvelle période, cependant, elle trouve désormais Israël comme son principal rival. Tout comme la Turquie, à travers les négociations d'Astana et de Sotchi, a pu créer un terrain de lutte avec la Russie et l'Iran malgré l'isolement des États-Unis, dans cette nouvelle phase, nous pourrions voir un processus où la Turquie apprend à faire face et à contrôler l'agressivité d'Israël.
Alors que les opérations militaires de la Turquie ont offert un espace de vie à l'opposition syrienne et nettoyé des régions du terrorisme, nous sommes maintenant confrontés à une équation où la Turquie doit soutenir la stabilité et l'intégrité territoriale dans toute la Syrie avec sa présence militaire directe.
Cela est significatif non seulement en termes de contribution à la stabilité de la Syrie et donc à la sécurité nationale de la Turquie, mais aussi comme un champ de compétition régionale entre la Turquie et Israël, renforçant la dissuasion turque contre Israël. Par conséquent, sur ce vieux champ de bataille, une nouvelle bataille attend la Turquie.
Après plus d'une décennie de guerre civile, Damas et Ankara s'engagent dans une stratégie à long terme.
Pour la Syrie, dont les capacités restent limitées, cette stratégie est le seul chemin réaliste pour restaurer la stabilité et l'intégrité territoriale. Le long terme consiste à gagner du temps : sortir de l'isolement diplomatique, attirer des investissements économiques, faciliter le retour des Syriens de l'étranger et reconstruire lentement l'autorité de l'État.
Israël, cependant, travaille à étouffer cette reprise dans l'œuf. Une Syrie stable, surtout soutenue par une présence turque croissante, défierait directement la capacité d'Israël à frapper au-delà des frontières, à manipuler des milices et à maintenir le « luxe » d'une intervention non contrôlée.
Là où Israël cherche une fragilité perpétuelle, la Turquie a la chance de construire une stabilité durable, et ce concours définira le prochain chapitre de la région.